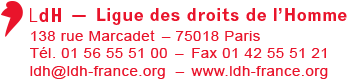Communiqué commun dont la LDH est signataire
Les nouveaux chiffres de la population carcérale au 1er octobre, publiés hier par le ministère de la Justice, marquent d’énièmes tristes records. Trente-deux organisations du milieu prison-justice dénoncent des annonces politiques insensées qui ne feront qu’aggraver cette situation dramatique. Quant aux orientations budgétaires actuellement discutées au Parlement, elles signent un gaspillage de l’argent public et l’impensé du sens de l’incarcération et de la sortie de prison.
79 631 personnes sont détenues dans les prisons au 1er octobre [1]. Sur les douze derniers mois, c’est la onzième fois que la France bat son propre record. En un an, ce sont 5 300 personnes supplémentaires qui sont incarcérées, et tandis que certains osent encore taxer la justice de laxiste, le ministère de la Justice prévoit que le nombre de personnes détenues dépasse 86 000 en 2027 [2].
Le nombre d’annonces politiques insensées lui, ne se compte plus. L’instauration de peines planchers est de nouveau débattue. Les comparutions immédiates, qui multiplient par huit la probabilité d’être condamné à une peine de prison ferme par rapport à une procédure de jugement classique [3], seraient élargies aux mineurs, dont l’atténuation de responsabilité serait en outre écartée dans un plus grand nombre de cas. L’augmentation des courtes peines de prison devient le nouvel étendard. Sans parler des aménagements de peine auxquels il faudrait moins recourir alors que, censés être le principe, ils concernaient au 1er août moins de 30% des personnes condamnées et écrouées [4].
Cette dynamique infernale alimente le sentiment d’insécurité de la population française, en dépit des enquêtes de victimation qui font état « d’une certaine stabilité des faits de délinquance dont les ménages ont été victimes » et d’un durcissement de la réponse pénale [5]. Elle a également pour effet de banaliser le recours à un emprisonnement qui, sans accompagnement professionnel, médical et/ou socio-judiciaire, a un impact nécessairement limité en termes de prévention de la récidive, voire contre-productif. Contre les chiffres et les travaux de recherche, le Gouvernement fonde ses projets de politique pénale sur un fantasme, ignorant la réalité carcérale.
La réalité est que près de 70% des personnes détenues sont enfermées dans des maisons d’arrêt, des établissements souvent vétustes et insalubres, infectés de nuisibles et avec un taux d’occupation moyen atteignant 155 % au 1er octobre. La réalité est qu’elles sont entassées dans environ 9 m² dans la promiscuité la plus totale, avec des toilettes ouvertes sur la cellule et des matelas posés au sol sur lesquels sont contraintes de dormir 3 810 personnes incarcérées. Des conditions qui rejaillissent sur l’ensemble des personnels qui travaillent entre les murs.
Les indicateurs de performance de l’administration pénitentiaire, publiés avec le projet de loi de finances, annoncent une aggravation de la situation. En 2025, le taux d’occupation moyen des maisons d’arrêt devrait dépasser 164% (+ 10 points). Cette projection, aussi alarmante soit-elle, n’en est pas moins logique : la construction de nouvelles places de prison, clé de voûte des politiques publiques proposées depuis des dizaines d’années n’a jamais permis de réduire la surpopulation carcérale. Déjà, en 1999, le Conseil de l’Europe recommandait que « l’extension du parc pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle puisqu’elle n’est pas, en règle générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement » [6].
Cette obsession pour la construction a un coût exorbitant. En 2025, l’administration pénitentiaire prévoit que la dette accumulée pour la construction de nouvelles places de prison approchera 5,4 milliards d’euros. La réinsertion des personnes placées sous main de justice, dont le nombre ne cesse de croître du fait de l’augmentation simultanée du nombre de personnes détenues et de personnes suivies en milieu ouvert, accuse une baisse d’1,4 million d’euros avec un budget autour de 120 millions d’euros. Aucune création d’emploi n’est prévue, hormis des personnels de surveillance pour les nouveaux établissements pénitentiaires. Autrement dit, le gouvernement se contente, dans les prisons déjà existantes, d’une situation d’inactivité forcée des personnes détenues et de profondes carences en termes d’accompagnement.
Alors que la dette française n’a jamais été aussi importante depuis la Seconde guerre mondiale [7], nos 32 organisations, mobilisées au quotidien sur l’ensemble des sujets relevant des politiques pénales et pénitentiaires, le disent avec gravité : le sens de l’incarcération et la sortie de prison sont des impensés, et l’argent public est gaspillé dans une surenchère sécuritaire aux effets désastreux.
Les orientations budgétaires de l’administration pénitentiaire pour 2025 sont aussi inefficaces qu’incompatibles avec le respect de la dignité humaine et la protection de la société. Mettre fin à la surpopulation carcérale ne devrait rien avoir d’un objectif secondaire. Au Royaume-Uni, face au risque d’atteindre un taux d’occupation de 100%, le gouvernement a engagé un plan d’urgence de libération de milliers de personnes détenues [8]. Il a confirmé qu’une régulation carcérale assumée politiquement n’était pas utopique. Les mesures adoptées en France pendant la crise sanitaire l’ont démontré, et 31 associations, syndicats et institutions françaises du monde prison-justice le soutenaient collectivement il y a un an [9] : il existe des moyens rapides et efficaces de réduire le nombre de personnes détenues. C’est une question de volonté.
Au-delà, nous avons besoin de réformes de fond visant à réduire le recours à l’incarcération et sa durée, fondées sur un changement de regard de la société. La prison ne doit plus être considérée comme la référence du système pénal, et ses alternatives, loin d’être symboliques, doivent se substituer à l’enfermement. Pour une évolution radicale de la politique pénale !
Signataires : A3D (association de défense des droits des détenus), ACAT-France, ANAEC, Anciens du Genepi, ANJAP, ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Personnes sous main de justice), ARAPEJ-41, ASPMP (Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire), Auxilia, une nouvelle chance, Ban public, CASP Arapej, CGT Insertion Probation, Citoyens & Justice, Clip, CNB (Conseil national des barreaux), CNDPIP (Conférence nationale des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation), Emmaüs France, FARAPEJ, FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité), FNUJA (Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats), La Cimade, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Lire c’est vivre, Lire pour en sortir, La Lucarne d’Ariane, Mouvement National Le CRI, OIP-SF, Possible, SAF (Syndicat des avocats de France), SM (Syndicat de la magistrature), Snepap-Fsu, SNPES-PJJ/FSU, UNDPIP (Union nationale des Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation)
Paris, le 30 octobre 2024
Télécharger le communiqué commun en pdf.
[1] « Statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée », Direction de l’administration pénitentiaire, octobre 2024.
[2] Inflation carcérale, Durcir les peines, remplir les prisons, Florence de Bruyn, Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, mars 2024.
[3] Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, La justice pénale est-elle discriminatoire ? Une étude empirique des pratiques décisionnelles dans cinq tribunaux correctionnels, 2013.
[5] « Une surpopulation carcérale persistante, une politique d’exécution des peines en question », octobre 2023.
[6] Comité des ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation n°R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, adoptée le 30 septembre 1999.
[7] JDD, Dette record : la France face à sa pire crise budgétaire depuis 1945, 2 octobre 2024.
[8] Le Monde, « Au Royaume-Uni, le gouvernement va libérer des milliers de détenus pour désengorger les prisons », 12 juillet 2024.
[9] « Surpopulation carcérale : seul contre tous, le gouvernement s’oppose à une solution d’urgence », communiqué de presse inter-associatif, 12 octobre 2023.